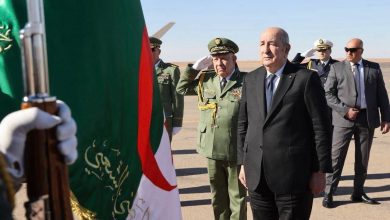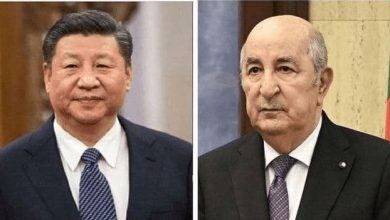SILA : conférence sur la pensée anticoloniale de Frantz Fanon
Une conférence sur le thème des «Questions de libération et critique du colonialisme et du néocolonialisme chez Frantz Fanon», retraçant la vie et la pensée éclairée de cet auteur et militant des luttes de libération en Afrique, a été organisée samedi soir à Alger, dans le cadre du programme culturel du 28e Salon international du livre d’Alger (SILA).
Accueillie à l’espace, «Esprit Panaf» au pavillon central du Palais des Expositions aux Pins maritimes, cette conférence a été animée par le professeur d’université, Wahid Benbouaziz, le spécialiste des littératures anglophones et francophones et responsable de l’»espace Afrique» au 28e Sila, Benaouda Lebdaï et le journaliste et écrivain américain, auteur d’une biographie consacrée à Frantz Fanon, Adam Shatz.
Abordant le thème de la violence dans les écrits de Fanon, les intervenants ont relevé que l’auteur de «Les damnés de la terre» dénonçait le colonialisme et le néocolonialisme en «analysant leurs effets déshumanisants et aliénants sur les colonisés» et l’»exploitation de la violence et l’instauration d’une domination psychologique et culturelle».
Dans ses analyses, poursuivent les conférenciers, Fanon soutient que la «libération ne peut être qu’une affaire de lutte collective et violente, menée par les opprimés eux-mêmes», afin de reconquérir «leur identité et dépasser le système colonial pour construire une nouvelle société».
Selon les orateurs, l’œuvre de Fanon, inspirée en partie du cas de l’Algérie, qu’il a soutenue pour la résilience de son peuple à en découdre avec le colonialisme français, aborde également la «nature de la violence coloniale» et la critique de la négritude en tant que «repli identitaire», ainsi que la nécessité de «décoloniser non seulement les structures mais aussi l’être», pour éviter d’avoir à subir une «simple africanisation vide de sens».
«La violence est le moyen par lequel le colonisé peut se libérer d’un système lui-même violent», tout en dénonçant l’«universalisme européen» qui se contredit en proclamant les droits de l’homme «tout en colonisant et en opprimant», ont encore expliqué les intervenants.
Outre les traumatismes psychologiques engendrés par la violence coloniale sur les populations, les animateurs à cette rencontre ont abordé l’influence de Frantz Fanon, sur la littérature algérienne, citant quelques extraits d’ouvrages de Kateb Yacine, Rachid Boudjedra, Maïssa Bey, Anouar Benmalek et Assia Djebbar, tout en relevant l’aspect prémonitoire de ses écrits, basé sur sa connaissance scientifique de l’homme et les projections rationnelles du psychiatre qu’il était.
Les intervenants ont enfin considéré que l’oeuvre fanonienne, riche, plurielle et réaliste, appelait au modernisme de la pensée humaine et se prêtait à plusieurs interprétations, au regard de ses dimensions poétique, imagée et orale, nourries par une pensée au déterminisme historique.